veille juridique janvier 2019
 haque mois, notre juriste-conseiller réalise une veille juridique sur les modifications des lois impactant nos domaines de compétences (urbanisme, architecture, environnement, habitat, etc.).
haque mois, notre juriste-conseiller réalise une veille juridique sur les modifications des lois impactant nos domaines de compétences (urbanisme, architecture, environnement, habitat, etc.).Urbanisme :
L’usage initial d’une construction abandonnée n’a pas à être pris en compte par l’administration saisie d’une demande d’autorisation de construire sur le bâtiment en cause (Conseil d’Etat).
Par arrêt du 28 décembre 2018 (n° 408743), le Conseil d’Etat précise que l’administration saisie d’une demande de permis de construire ne peut légalement fonder sa décision sur l’usage initial de la construction en cause lorsque cet usage a depuis longtemps cessé en raison de son abandon. « Si l’usage d’une construction résulte en principe de la destination figurant à son permis de construire, lorsqu’une construction, en raison de son ancienneté, a été édifiée sans permis de construire et que son usage initial a depuis longtemps cessé en raison de son abandon, l’administration, saisie d’une demande d’autorisation de construire, ne peut légalement fonder sa décision sur l’usage initial de la construction ; il lui incombe d’examiner si, compte tenu de l’usage qu’impliquent les travaux pour lesquels une autorisation est demandée, celle-ci peut être légalement accordée sur le fondement des règles d’urbanisme applicables »
Dans cette affaire, le propriétaire d’un terrain sur lequel était implantée une ancienne bergerie a sollicité la délivrance d’un Permis de Construire en vue de la réhabilitation de ce bâtiment à des fins d’habitation. Le 7 octobre 2011, le maire de la commune d’H. (Var) a refusé de lui délivrer le PC sollicité. Le pétitionnaire a alors demandé l’annulation de cet arrêté du 7 octobre 2011 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 7 décembre 2011. Par jugement du 15 octobre 2014, le Tribunal Administratif de Toulon a rejeté sa demande, rejet confirmé par la Cour Administrative d’appel de Marseille. Le pétitionnaire se pourvoit ainsi en cassation contre cet arrêt du 6 janvier 2017.
En premier lieu, il convient de préciser que le règlement du Plan d’Occupation des Sols (POS) de la commune dont il est question, autorise :
- pour les constructions à usage d’habitation existantes : uniquement les travaux visant à améliorer le confort et la solidité des bâtiments ;
- pour les constructions existantes à usage agricole : uniquement les constructions nouvelles à caractère précaire et démontable.
Dès lors, la bergerie étant initialement à usage agricole, le POS n’autorisait que des constructions nouvelles à caractère précaire et démontable. Or, la demande du pétitionnaire portait sur la réhabilitation du bâtiment à des fins d’habitation.
En deuxième lieu, le Conseil d’Etat juge alors que :
« Si l'usage d'une construction résulte en principe de la destination figurant à son permis de construire, lorsqu'une construction, en raison de son ancienneté, a été édifiée sans permis de construire et que son usage initial a depuis longtemps cessé en raison de son abandon, l'administration, saisie d'une demande d'autorisation de construire, ne peut légalement fonder sa décision sur l'usage initial de la construction ; il lui incombe d'examiner si, compte tenu de l'usage qu'impliquent les travaux pour lesquels une autorisation est demandée, celle-ci peut être légalement accordée sur le fondement des règles d'urbanisme applicables. »
Ainsi, l’usage d’une construction résulte en principe de la destination figurant à son PC. Cependant, lorsqu’une construction ancienne a été édifiée sans PC et a été abandonnée depuis longtemps, l’administration saisie d’une demande d’autorisation de construire sur le bâtiment en cause, ne peut fonder sa décision sur l’usage initial de la construction.
Dès lors, il incombe à l’administration d’examiner si l’usage du bâtiment pour lequel les travaux sont demandés, est conforme aux règles d’urbanisme applicables.
En troisième lieu, le Conseil d’Etat rappelle que la construction litigieuse a été édifiée au XIXe siècle sans qu’un PC ne soit nécessaire à l’époque. Toutefois, le Conseil d’Etat relève également que la bergerie a été abandonnée pendant plusieurs décennies et que cette circonstance de fait ne permet pas de considérer le bâtiment comme étant réduit à l’état de ruine.
En dernier lieu, le Conseil d’Etat en déduit alors que la Cour Administrative d’appel de Marseille a commis une erreur de droit en jugeant que cette construction était à usage agricole parce qu’elle avait été initialement utilisée comme bergerie. En effet, le Conseil d’Etat juge que l’usage agricole initial ne pouvait être pris en compte dès lors que cet usage avait cessé depuis des décennies.
En conséquence, la Haute juridiction précise sa jurisprudence relative à l’usage du bâtiment objet de la demande de PC. En effet, après avoir jugé que l’administration n’était pas tenue de prendre en compte l’usage réel du bâtiment en cause en lieu et place des indications figurant dans la demande du pétitionnaire (Cf. notre commentaire de l’arrêt du Conseil d’Etat du 18 juillet 2018 n° 410465), le Conseil d’Etat précise que l’administration ne doit pas non plus tenir compte de l’usage initial du bâtiment lorsque celui-ci a été abandonné.
Régime des travaux sur existant
L'administration qui n'a pas pointé la non-conformité des travaux autorisés à la suite d'une déclaration d'achèvement ne peut exiger du pétitionnaire, à l'occasion de travaux ultérieurs, le dépôt d'une demande d'autorisation globale en vue régulariser l'existant.
Le Conseil d'État complète le dispositif jurisprudentiel relatif au régime des travaux réalisés sur un bâti irrégulier. L'hypothèse envisagée ici est celle d'un constructeur qui, dans un premier temps, procède à des travaux qui ne respectent pas l'autorisation dont il dispose et qui, ultérieurement, cherche à engager un nouvel épisode de travaux sur la construction. Un cas de figure qui conduit le Conseil d'État à prendre en compte les modalités de contrôle de la conformité des travaux après l'envoi d'une Déclaration d'Achèvement et de Conformité (DAACT) en application des articles L.462-2 et R.462-6 du Code de l'urbanisme.
Il résulte en effet de l'article R. 462-6 du Code de l'urbanisme que lorsque le bénéficiaire d'un permis ou d'une non-opposition a adressé au maire une DAACT, l'autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration si elle ne l'a pas fait dans le délai, suivant les cas, de 3 ou de 5 mois. Le Conseil d'État en déduit que si l'administration n'a pas relevé d'anomalie à la réception de la DAACT, les contraintes de régularisation a posteriori issues de la jurisprudence Thalamy (CE, 9 juill. 1986, n° 51172) et de ses développements ultérieurs (CE, 25 avr. 2001, n° 207095 ; CE, 13 déc. 2013, n° 349081) deviennent inopposables au pétitionnaire. Dans cette hypothèse et sauf le cas de fraude, l'administration ne peut donc exiger du propriétaire qui envisage de faire de nouveaux travaux qu'il présente une demande de permis ou dépose une déclaration portant également sur des éléments de la construction existante au motif que celle-ci méconnaîtrait le PC précédemment obtenu ou la Déclaration Préalable précédemment déposée.
CE, 26 nov. 2018, n° 411991
Les marchés publics et les concessions ont enfin leur code
Regroupant les principaux textes applicables, dont les ordonnances « marchés publics » et « concessions » ou encore la loi MOP (loi relative à la Maîtrise d’Ouvrage Publique), le nouveau Code de la commande publique entrera en vigueur le 1er avril 2019.
Souvent annoncée, longtemps repoussée, la codification des textes relatifs aux contrats publics est enfin achevée. Baptisé « Code de la commande publique », ce nouveau corpus juridique est institué par l'ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 pour la partie législative et le décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 pour la partie réglementaire. Ces textes ont été tous deux publiés au Journal officiel du 5 décembre 2018. Toutefois, ils ne produiront leurs effets qu'à l'égard des contrats pour lesquels une consultation sera engagée ou un avis d'appel à la concurrence sera publié à partir du 1er avril 2019 (Ord. n°2018-1074, 26 nov. 2018, art. 20 : JO, 5 déc. ; D. n°2018-7075, 3 déc. 2018, art. 16 : JO, 5 déc.). Le Ministère de l'économie justifie ce délai par la nécessité de laisser aux acheteurs publics et aux opérateurs économiques le temps de maîtriser la nouvelle organisation des normes, en prenant soin de préciser que le contenu de celles-ci n'est que peu modifié. En effet, exception faite de quelques modifications apportées à des fins de correction ou d'harmonisation, la codification est effectuée à droit constant.
Le Code de la commande publique a ainsi pour objectif d'améliorer l'accessibilité du droit, en remédiant à l'éparpillement des législations applicables aux contrats publics.
A cet effet, il abroge et remplace les textes existants, parmi lesquels figurent notamment :
- l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et ses décrets d'application n°2016-360 et n°2016-361 du 25 mars 2016, relatifs aux marchés publics ;
- l'ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 et son décret n°2016-86 du 1er février 2016, relatif aux contrats de concession ;
- la loi MOP n°85-704 du 12 juillet 1985 et ses décrets d'application, dont celui n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées à des prestataires privés ;
- la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
Ces différents régimes ne sont pas simplement juxtaposés. Ils sont intégrés dans l'architecture globale du code, structurée autour d'un titre préliminaire, relatif aux grands principes de la commande publique, et des parties suivantes :
- une première partie, consacrée au champ d'application du code de la commande publique, qui définit les contrats concernés et les acheteurs visés ;
- une deuxième partie, regroupant l'ensemble des dispositions relatives aux marchés publics, qui s'ouvre sur le régime général avant d'exposer chaque régime spécifique (contrats de partenariat, marchés de défense et de sécurité, maîtrise d'ouvrage publique, contrats de prestations intégrées) ;
- une troisième et dernière partie relative aux contrats de concession.
Conforme au diptyque identifié par le droit communautaire, cette présentation rattache ainsi chaque contrat à l'un des deux régimes principaux, celui applicable aux marchés ou celui encadrant les concessions.
En outre, afin d'améliorer la lisibilité de l'ensemble, chaque subdivision est insérée suivant l'ordre chronologique des différentes étapes d'une relation contractuelle (préparation du contrat, passation, exécution).
Enfin, l'ordonnance du 26 novembre 2018 et le décret du 3 décembre 2018 procèdent au toilettage des dispositions législatives et réglementaires faisant référence aux textes codifiés. Pour éviter toute confusion résultant d'un éventuel oubli, ils prévoient, à titre de règle générale, que toute mention relative aux ordonnances « marchés publics » ou « concession » ou à leurs décrets doit s'entendre comme visant le Code de la commande publique (Ord. n°2018-1074, 26 nov. 2018, art. 17 ; D. n°2018-1075, 3 déc. 2018, art. 13). Par extension, il devrait, a priori, en aller de même pour toutes les références à l'ancien code des marchés publics ou à l'ancienne ordonnance du 6 juin 2005, bien que celles-ci ne soient plus expressément visées.

Trouvez un ouvrage, une revue, etc.
Avec notre moteur de recherche en ligne, trouvez le livre qui vous intéresse parmi plus de 1 700 références !
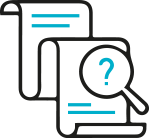
Des réponses à vos
questions !
Des questions sur les autorisations d’urbanisme, les contrats, les voisins, etc. Consultez nos fiches pratiques téléchargeables !

L’Observatoire CURIOSITE
La Gironde en un clin d'oeil. L'Observatoire CURIOSITE c'est une autre vision de l'architecture et du paysage girondin !